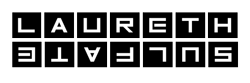LAURETH SULFATE






Texte de Marie Deparis-Yafil, philosophe, critique d’art et commissaire d’exposition
Catalogue de l’exposition AINSI SOIENT-ELLES
Centre d’art contemporain Jean-Prouvé
29 Mars – 1er Juin 2025
63500 Issoire
[…]
Je suis comme je suis
Je suis faite comme ça
Que voulez-vous de plus
Que voulez-vous de moi
[…]
Jacques Prévert
in Paroles, 1946
Le titre choisi par l’artiste Laureth Sulfate pour son exposition personnelle au Centre d’art Jean-Prouvé d’Issoire, «Ainsi soient-elles», invite d’emblée à un imaginaire polysémantique, et, avant même d’avoir pénétré dans l’exposition, nous pressentons déjà que nous allons y découvrir un univers iconoclaste, énergique, probablement engagé vers l’évocation d’une féminité multiple et sororale, mais aussi peut-être teinté d’une forme de spiritualité. Nos attentes ne sont déçues…
«Ainsi soit-il», locution classique dans le discours liturgique –équivalent de Amen– , s’inscrit littéralement comme la conclusion d’une prière: «Espérons qu’il en soit ainsi», ou encore «Acceptons qu’il en soit ainsi» ou peut encore être appréhendé comme une injonction «Qu’il en soit ainsi», c’est-à-dire, tel que Dieu, et-ou ses Saints, le veulent.
Dieu et les Saints, nous le savons, sont souvent des hommes et en choisissant de féminiser et de rendre plurielle cette locution, Laureth Sufate érige d’emblée une loi nouvelle, que l’on pourrait tenter de résumer de cette manière: ainsi faut-il désormais agir tel que les femmes sont, veulent être –ou ne plus être–, seront désormais, poussées par un vent que d’aucun trouveront libertaire, et qui, d’une certaine manière, définit assez bien l’œuvre, les femmes, et la personnalité, puissantes et libres, de Laureth Sulfate.
L’exposition se déploie dans une double dimension prospective-rétrospective. La grande salle présente pour la plupart des œuvres récentes et inédites, certaines spécifiquement réalisées pour le Centre d’art d’Issoire, tandis que les salles attenantes reviennent sur des thématiques et des œuvres qui ont jalonné le parcours artistique de Laureth Sulfate, ainsi que sur la commande que la Ville avait faite à l’artiste d’une fresque, «Le bal des abeilles», que l’on peut admirer Place Suzanne Noël, rendant hommage à cette personnalité historique de l’après-Grande Guerre et pionnière de la chirurgie réparatrice.
Au premier plan de cette proposition foisonnante, l’installation interactive «Ainsi soient-elles» présente une série de sept sculptures de vierges Marie –sept, comme le chiffre symbolisant la perfection spirituelle dans la tradition hermétique et la kabbale– sur fond de drapés blancs évoquant, selon, des voiles virginaux, des plis baroques, des suaires ou encore de christiques perizonium.


L’artiste a, à dessein, choisi une représentation sculpturale classique, afin de pouvoir en détourner l’iconographie et y superposer des éléments plus iconoclastes. La figure de la Vierge constitue un élément central dans la spiritualité mais aussi, avec le temps, dans la perception de «l’être-femme». Incarnant tout ce à quoi l’humanité peut aspirer : la foi, l’espérance, le dévouement, la générosité, la compassion…, ce modèle de vertu pourrait sembler obsolète dans notre monde déchiré, mais l’intérêt que portent les artistes contemporains à cette incontournable figure de l’histoire de l’art démontre à quel point elle prend encore sens aujourd’hui, ouvrant à tout un pan de réflexion sur ce que recouvrent aujourd’hui nos aspirations à la bienveillance, à l’inclusion, à une redéfinition des contours de l’«être-femme»…

Retravaillées plastiquement, chacune d’entre elles «s’anime dans un souffle de réalité augmentée, chacune portant une voix unique.», explique l’artiste. «Certaines Vierges murmurent une prière sous forme de chant, des mots d’espoir et de pardon. D’autres, plus légères, entonnent simplement une chanson, comme un écho des émotions universelles portées par les femmes à travers l’histoire, (…), gardiennes vivantes d’un dialogue entre la douleur et la lumière, la mémoire et la transcendance, révélant un pont entre l’histoire humaine et l’éternité» dit-elle encore. L’artiste évoque ainsi des figures de femmes fortes malgré l’adversité et la guerre: sorcières, pourchassées et assassinées au nom de Dieu, «Canary Girls»(1) ou «Radium Girls»(2), sacrifiées au nom de la guerre…

Complétant ce dispositif, l’artiste a imaginé une manière originale et, avec humour, irrévérencieuse, de découvrir quelques-unes de ses vidéos. L’œuvre «sous les jupes des femmes» mixe d’une certaine façon l’esthétique d’un prie-dieu et une forme sculpturale féminine, cachant un écran sous les plis de sa jupe. Entre chaire et confessionnal, cette proposition insolite permet de s’isoler et de s’immerger dans un univers particulier, spirituel et poétique, sulfureux parfois, faisant écho à la réflexion que l’artiste poursuit sur l’«être-femme», entre transitions et métamorphoses, imaginaires et fantasmes.
Il est sans doute opportun de s’arrêter ici un moment sur ce qui fait la spécificité et la richesse de l’écriture polymorphe de Laureth Sulfate. Depuis plusieurs années, elle déploie en effet un large arsenal de médiums et de techniques, dont la maîtrise permet de réaliser une œuvre à l’envergure multiple, hybride et baroque, tant sur les plans formel que sémantique, entre sculpture, installation, chant, performance, vidéo ou encore photographie, pour créer des œuvres parfois immersives, interactives, croisant les genres et les limites entre réalité et numérique .
Nombre de ses travaux s’appuient sur un premier temps de prise de vue photographique, soigneusement mise en scène, chorégraphiée, dans laquelle les costumes, les maquillages, les poses sont essentiels. Un travail «traditionnel» de photographie qui s’efface ensuite au profit d’un re-travail plus pictural, d’une composition étudiée, tenant du collage.
Ici s’ouvre l’étape d’un processus faisant appel au numérique, à la palette graphique, permettant ce rendu coloré, vif, à la fois précis et foisonnant. Le dyptique du «Bal des abeilles», reproduit ici dans son intégralité(3), illustre parfaitement cette profusion visuelle, toujours doublée d’une multiplicité des symboles et des récits. L’artiste sait ainsi mixer avec justesse des techniques traditionnelles de l’art avec des techniques plus innovantes telles que l’IA ou la réalité augmentée…
Artiste complète, elle ose, sans se limiter et sans étiquette, faire appel à ses multiples talents : pour la série «Ainsi soient-elles», c’est elle qui a composé et chante le «chœur des vierges», elle encore qui interprète, la dangereuse danse de la performance «Metonomia»(2019), ou sous le voile blanc, la mystérieuse silhouette de la série «Un monde hors de ses gonds» (2019).
La Vierge semble encore là, résistante, résiliante, comme une figure de proue, émergeant du chaos, de la destruction, des gravats, de cette ère contemporaine qui tient plus du jeu de la mort que de l’aire de jeu, et dans laquelle le temps, l’espace, l’humanité même, semblent disjoints, pour reprendre l’expression de Shakespeare (« the time is out of joint »)(4) qui inspire l’artiste.
Dans cette série purement photographique, l’artiste, robe blanche la couvrant intégralement, si ce ne sont ses bras, ses mains, comme des capteurs, des appels, erre dans un paysage de fin, semblant chercher quelque chose, une issue, une révélation peut-être, ou comment réparer ce monde désarticulé, dérangé, déréglé, «hors de ses gongs».
Et puis il y a ce geste, qui est celui des conspirateurs et des enfants, des sages et des anges, ce geste du mystère, du secret, du silence, chut!, le doigt posé sur les lèvres: And still your fingers on your lips, I pray, dit encore Hamlet. Quelque part parmi les photographies, la silhouette blanche actant le signe harpocratique atteste du souci de compréhension des mystères du monde et de spiritualité qui l’anime.
Cette aspiration ne sera pas contredite par la série des «Lunatika», série en cours de dessins largement inspirée des mandalas et de leur usage jungien. Réalisé à partir de motifs élaborés directement à la pointe fine, de manière libre, cet ensemble de dessins invite, explique l’artiste, «à un voyage intérieur, où l’art du mandala rencontre l’univers mystérieux de la lune», dont l’influence, sur la nature comme peut-être sur notre psyché, est une question scientifique et ésotérique débattue depuis des siècles. Chaque dessin, aire rituelle, appelle autant au vagabondage de l’esprit qu’à la méditation, et devient ainsi «un miroir de l’inconscient, un champ d’énergie symbolique qui reflète les archétypes dans leurs dimensions les plus profondes et universelles.»


Bien qu’empreinte de cet authentique souci de spiritualité, l’œuvre de Laureth Sulfate s’inscrit résolument et joyeusement dans le tumulte du monde, notamment en s’emparant de la rue.
Longtemps, et aujourd’hui encore, Laureth Sulfate a arpenté –et récupéré parfois– les pavés de Lyon, pour y déposer ses œuvres et ses actions performatives.
Pour elle, à l’instar de nombreux artistes de street-art, la question du passage de la rue-atelier, comme le disait Daniel Buren, au mur des lieux d’art et musées est un objet de réflexion. Comment faire entrer avec cohérence un art destiné à être perçu par le grand public dans la liberté et le brouhaha de la rue dans le contexte, forcément différemment signifiant, comme tous les artistes le savent depuis Marcel Duchamp, du «lieu de monstration de l’art»? Un vaste débat que l’artiste tente de résoudre à sa manière en retravaillant spécifiquement –par les techniques et les dimensions–, pour l’intérieur, des projets qui existèrent dehors.
Ainsi du projet des «Corona Girls»(2020-2021) qui naquirent au moment de l’épidémie mondiale de la Covid-19 et se répandirent d’abord sur les murs de la ville. Au premier regard, les œuvres font écho à toute une iconographie fifties: une imagerie pop issue des pin-up d’après-guerre, d’une féminité, donc, exacerbée et conforme à un modèle déterminé de posture et de séduction. Mais il s’agit bien entendu de se réapproprier ces codes pour les transfigurer, et en modifier le sens. De séductrices convenues, ces femmes se dessinent comme des guerrières –le terme «corona girl» faisant à la fois référence aux «Canary Girls» et «Radium Girls» que nous avons évoqué plus haut– des femmes fortes, infirmières, médecins, luttant contre la maladie et la mort.
À l’inverse du travail sur les «Corona Girls» –mais il s’agit au fond de l’autre face du même questionnement–, la série développée autour du port de la burqa, et de la performance que l’artiste réalisa, re-questionne la visibilité du corps féminin dans l’espace public, ici par son invisibilisation justement qui, par sa dimension pour nous fantomatique, le signale d’une manière négative, par soustraction.
Il apparaît ainsi clairement que, d’une manière ou d’une autre, la question du corps des femmes, dans toutes les occurrences politiques et sociétales qu’il implique, autant que poétique et fantasmatique, est bien au cœur des préoccupations de l’artiste.

Dans la dimension rétrospective de l’exposition, une des salles revient sur un travail que l’artiste a développé autour d’une figure de la culture pop, le Joker, ici traité au féminin. Comme un double maléfique et séducteur, «la» Joker questionne les parts sombres, la noirceur sous des dehors colorés, une esthétique dionysiaque –cette folie qui parcourt toute l’œuvre de Laureth Sulfate et qui récuse à l’évidence, pour reprendre la dichotomie nietzschéenne(5), la tentation du calme apollonien, d’une femme apollonienne, docile et mesurée–. Ici trouve-t-on une expression de la démesure, de l’hubris qui caractérise le travail de Laureth Sulfate, mais aussi, parce qu’il n’y a souvent pas de dionysiaque sans tragédie, un visage de la résilience –comment sortir vainqueur d’une tragédie–. Questionnement récurrent dans l’histoire des femmes, intimement parallèle à celle de la nature– que, par exemple, la «Tueuse de homard» illustre –malmenées les unes comme l’autre par l’impérialisme du patriarcat systémique, de la violence et des mécanismes de domination.
Le diptyque du «Bal des abeilles» synthétise, plastiquement et symboliquement, ces nombreuses représentations et préoccupations égrenées dans l’œuvre de Laureth Sulfate.
D’un côté, des femmes puissantes, chirurgiennes, infirmières, avocates, poétesses, aventurières… sont embarquées sur une folle nef, déclinant des figures symboliques de reconstruction, d’espoir, de monde nouveau, de réinvention, dans une composition fourmillant de détails signifiants.
De l’autre, les voici débarquant sur une terre a priori hostile, «ténébreuse et incertaine». Un «monde perdu», décrit l’artiste, le monde disjoint que nous évoquions tout à l’heure. L’œuvre prend alors une tournure eschatologique nettement moins joyeuse, comme une fin de partie. Et ce ne sont pas seulement les femmes mais l’humanité tout entière qui, désormais, tente d’éviter que la partie ne soit définitivement perdue, et que la prédiction nietzschéenne ne se réalise : «En quelque coin écarté de l’univers répandu dans le flamboiement d’innombrables systèmes solaires, il y eut une fois une étoile sur laquelle des animaux intelligents inventèrent la connaissance.
Ce fut la minute la plus arrogante et la plus mensongère de « l’histoire universelle » : mais ce ne fut qu’une minute.
À peine quelques soupirs de la nature et l’étoile se congela, les animaux intelligents durent mourir.»(6)
Marie Deparis-Yafil
Janvier 2025
(1) Durant la Première guerre mondiale, en Angleterre, des femmes travaillaient dans la fabrication d’obus à base de trinitrotoluène (TNT). L’exposition prolongée à cette substance toxique finissait par donner à leur peau une couleur jaune orangé d’où le surnom de «Canary Girl».

(2) De 1917 à 1926, l’United States Radium Corporation se lance dans l’extraction et la purification du radium à partir du minerai de carnotite afin de produire une peinture fluorescente, fournissant l’armée américaine en montres radioluminescentes. Les «Radium Girls» sont les ouvrières américaines embauchées pour peindre les cadrans de montre et qui, exposées à cette substance, ont commencé à souffrir d’anémie, de fractures osseuses, et de nécrose de la mâchoire., puis de tumeurs cancéreuses des os. Tandis que les chimistes, connaissant les effets nocifs du radium, évitaient soigneusement de s’exposer au danger, utilisant des écrans de plomb, des masques et des pinces, on demandait aux ouvrières d’épointer les pinceaux avec leurs lèvres, ou de se servir de leur langue pour les effiler. De nombreux décès survinrent, et permirent d’ouvrir un procès historique pour l’histoire du travail ouvrier, à la fin des années 20.
(3) Seule la première partie de ce diptyque est présenté sur la place Suzanne Noël d’Issoire.
(4) William Shakespeare – Hamlet (Acte 1, scène 5), Circa, 1599.
(5) Voir Friedrich Nietzsche, La naissance de la tragédie, 1872.
(6) Friedrich Nietzsche, Le Livre du philosophe, III, 1873.